Actualités
- Détails
- Catégorie : Actualités

Ethnologue, Nicolas Sihlé a enseigné de 2002 à 2010 dans le département d’anthropologie de l’University of Virginia (Etats-Unis), avant de rejoindre le CNRS et le Centre d’Etudes Himalayennes. Son travail est centré sur un type de religieux, le tantriste (ngakpa), figure clé du versant non monastique du bouddhisme tibétain. A partir d’un travail ethnographique conduit dans le nord du Népal (Baragaon / Mustang inférieur et Dolpo), il a publié ce livre intitulé Rituels bouddhiques de pouvoir et de violence : La figure du tantriste tibétain. Il s’y penche sur les caractéristiques marquantes de cette forme de spécialisation bouddhique ; à savoir : une orientation très ritualiste (avec une importante composante magique), la pratique de rituels tantriques mobilisant un pouvoir fort, voire une violence rituelle (qui revêt ici une centralité assez paradoxale dans un contexte bouddhique), l’association entre légitimité et pouvoir rituels d’un côté et lignée héréditaire de l’autre, ou encore la relative absence de références au renoncement.
Compte-rendu par Cécile Ducher
“Dans cet ouvrage, Nicolas Sihlé reprend, tout en les remaniant en profondeur, les travaux résultant de sa thèse de doctorat intitulée : « Les tantristes tibétains (ngakpa), religieux dans le monde, religieux du rituel terrible : étude de Ch’ongkor, communauté villageoise de tantristes du Baragaon (nord du Népal) ». Entre la soutenance de la thèse (2001), et la publication de ce présent livre (2013), un cycle de douze années s’est écoulé, et c’est en réalité à une renaissance que l’on assiste, tant le texte a été repensé, remanié et amplifié. Entre temps, le titre a évolué, pour passer d’une association locale, Ch’ongkor, à une évocation plus universelle du sujet de l’ouvrage : Rituels bouddhiques de pouvoir et de violence : la figure du tantriste tibétain. L’auteur aurait d’ailleurs pu aller plus loin en faisant le choix de l’intituler Vers une anthropologie du bouddhisme tantrique — du nom d’une des sections de l’introduction — tant l’ouvrage propose à son lecteur une introduction didactique au vaste domaine de l’anthropologie du bouddhisme, plus particulièrement sous sa forme tantrique tibétaine, jusqu’alors peu exploré si ce n’est dans des contextes monastiques.
- Détails
- Catégorie : Actualités de l'IEB

Didier Treutenaere nous entraîne ici dans un passionnant voyage au cœur du Siam, du dix- neuvième au vingtième siècle, à travers l'évocation du grand maître bouddhiste, et en particulier nous fait mesurer les évolutions d'une nation qui a fait du bouddhisme son socle social. Nous vous ferons partager de larges extraits de ce travail de recherche au cours des prochaines newsletters.
Prologue
Le Siam1, au tournant du siècle dernier, était un pays vert et luxuriant, un pays de rizières aux cours d’eau miroitants encombrés par les barges chargées du riz destiné à la capitale royale. La société était pacifique, le peuple doux, tolérant et profondément enraciné dans l’héritage bouddhiste, pilier de la société siamoise depuis le treizième siècle. À cette époque, le Siam était, matériellement, pauvre. La simplicité matérielle préservait les vertus simples de l’existence.
Au Siam, l’ordre social reposait sur le foyer, sur les liens familiaux, faits de chaleur et d’obligations entre père et fils, mère et fille, frère et sœur, bien plus proches que tout ami ou relation. Le foyer était le cœur de la société.
Dans les autres pays, les routes venaient en premier et les maisons étaient ensuite construites le long des routes ; pas au Siam : les maisons venaient en premier et les routes devaient se conformer aux emplacements des maisons.
- Détails
- Catégorie : Actualités de l'IEB

Nous avons le plaisir de vous présenter un extrait de l'enseignement de Philippe Cornu à l'IEB, à propos d'un sujet très classique et fondamental dans le bouddhisme, la question des « passions ». Son approche très pédagogique, accessible à tous les lecteurs et étudiants, apporte une force et une vigueur particulière sur un sujet délicat et fort débattu mais pas assez souvent clarifié.
Après avoir traité des onze facteurs vertueux, dont la non-violence, l'antidote de la violence, qui consiste à ne pas brutaliser les êtres animés (et évidemment de ne pas commettre de meurtre), mais ne pas les contraindre non plus, et plutôt de leur montrer de la compassion, le texte nous dit que la compassion empêche la destruction des mérites, la dite destruction des mérites étant le plaisir égotique. En effet la compassion consistant à se mettre à la place de l'autre et prendre sur soi la souffrance d'autrui, c'est à la fois un acte d'amour et de compassion et également quelque chose qui fait accumuler des mérites et une énergie positive sur le chemin. Cette énergie nous permet à la fois d'être en interaction avec les êtres et de continuer par la suite quand nous atteindrons la bouddhéité l’œuvre de grande compassion.
- Détails
- Catégorie : Actualité en francophonie
Jean- Noël Robert, Collège de France, chaire Philologie de la civilisation japonaise (extrait)
Il faut enfin souligner que la lecture qui a été la nôtre, fondée sur la reconnaissance de la structure bouddhique profonde de l’œuvre, ne visait certes pas à l’originalité, car elle est probablement la plus régulièrement soutenue par les commentateurs anciens, pour disparaître ensuite graduellement des travaux des philologues tenant des « études nationales » (kokugaku), lesquelles, en portant cette œuvre au pinacle bien avant « l’occidentalisation » du concept de littérature, avaient tout intérêt à la présenter comme la plus indépendante possible des influences continentales. Les faits, pourtant, continuent d’être têtus et nous pensons avoir pu montrer au cours de l’année comment les doctrines bouddhiques informent toutes les dimensions du roman, jusque dans son organisation interne. Ce que nous pouvons saisir de la personnalité de la romancière grâce à son Journal ou Notes journalières (nikki) que nous avons la chance de posséder, rend tout à fait probable cette structuration bouddhique, dont certains éléments essentiels n’ont pas échappé aux commentateurs anciens, et il a été important de mettre en relief ce que Murasaki-shikibu nous disait d’elle-même avant d’aborder son œuvre. ***
Nous assumerons évidemment que les grandes lignes du roman sont connues : il relate la vie du protagoniste, le « Radieux Genji », Hikaru Genji sur un demi-siècle, suivi d’une quinzaine d’années (environ entre 15 et 30 ans) de celle de son fils adoptif Kaoru. Le prince Genji est fils de l’empereur fictif Kiritsubo-in et de l’une de ses concubines de rang mineur. En butte aux jalousies, sa mère meurt peu de temps après sa naissance, et l’enfant, élevé à la cour, recevant l’éducation la plus raffinée, se distingue rapidement par sa beauté et son intelligence. Doué de tous les talents, il se précipite très tôt dans une succession d’aventures amoureuses qui formeront la matière du roman. Elles acquièrent aussi une dimension politique, car le Prince ne reculera pas devant l’une des pires fautes qui se puissent commettre en ayant une liaison avec l’une des épouses de son père. Il en naît un fils qui accédera ensuite au trône. Son amour principal est cependant celui qu’il entretient avec la toute jeune Murasaki-no-ue, dont le destin sera fort malheureux, comme celui d’ailleurs de la plupart des personnages féminins. Après des vicissitudes politiques dont certaines lui vaudront l’exil, le Genji finit par triompher lorsque l’une de ses filles devient impératrice. Le héros disparaît littéralement aux trois quarts du livre, sans que sa mort soit décrite. Les derniers dix chapitres décrivent à nouveau les amours contrariées de son fils adoptif Kaoru, rival du prince Niyoumiya, petit-fils du Genji. Le roman se termine dans une ambiguïté qui a mené beaucoup à estimer qu’il était inachevé, sans compter que nombre de commentateurs ont aussi considéré les dix derniers chapitres comme l’œuvre d’un auteur différent. Notre enquête nous a amené à penser que l’ambiguïté de la fin est voulue par la romancière et qu’elle est cohérente avec la teneur fondamentale du livre si l’on en reconnaît la portée bouddhique. . ***
Nous n’avons pas non plus à revenir en détail sur la personnalité de l’auteure, d’autant plus que nous ignorons presque tout d’elle, jusqu’à son nom, qui est en réalité une allusion à l’héroïne principale du roman, la princesse Murasaki. Mais ce qu’elle nous dit d’elle-même dans son Journal est déjà très éclairant. Il y a des faits bien connus et souvent répétés par les biographes : tout d’abord que la romancière avait des lettres chinoises une connaissance singulière qu’elle explique ainsi : alors que mon frère cadet, enfant, étudiait le Classique des Documents historiques [= le Shujing chinois], j’apprenais en écoutant. Lui, il lisait lentement, et oubliait tout, alors que moi, je faisais preuve d’une intelligence étonnante, si bien que notre père, qui était passionné de ces textes, se prenait constamment à soupirer : « Quel dommage, ce n’est vraiment pas de chance que je ne l’ai pas eue comme fils ». Comme toujours dans son Journal, Murasaki-shikibu ne s’embarrasse pas de fausse modestie, tout en nous donnant une raison somme toute acceptable de son érudition : elle ne l’avait pas fait exprès, et l’on voit dans ce passage s’esquisser la même préoccupation que dans l’anecdote précédente à propos de la Dame aux Histoires, le souci de ne pas passer pour une pédante ; cela est déjà ridicule chez un homme, que dire alors d’une dame de la cour ? Elle nous avoue ainsi que pour ne pas prêter à la moquerie, elle a longtemps fait semblant de savoir à peine écrire, préférant la honte de l’ignorance à la réputation de bas-bleu. Mais elle ne put rester longtemps dans ce semblant d’illettrisme, car l’impératrice elle-même (qui devait donc savoir à quoi s’en tenir sur ses connaissances littéraires) lui demanda d’exposer des passages des Œuvres de Bo (Bai) Juyi / Hak-Kyoi, le grand poète chinois du ixe siècle, dont nous avons vu l’importance primordiale dans le Japon de Heian lors du cours sur le Wakan-rôei-shû. Comme sa maîtresse voulait en connaître plus en détail le contenu, elle lui faisait des cours depuis deux ans au moment où elle écrivait son Journal, choisissant les moments où il n’y avait personne aux alentours ; l’empereur lui-même et d’autres grands ayant eu vent de la chose, la malheureuse dut multiplier ses leçons privées, mettant ainsi à mal le masque dont elle avait voulu s’affubler. On voit donc que son érudition chinoise n’était pas mince, et ces remarques du Journal nous sont fort précieuses pour comprendre que nous ne pouvons craindre d’aller trop loin dans la recherche des sources chinoises dans le Roman, dont nous verrons qu’elles sont l’une des deux dimensions majeures. ***
Le Journal nous donne cependant en plus des détails nombreux et précis sur une autre dimension des réflexions de la romancière, dont, curieusement, la critique moderne fait moins grand cas et semble hésiter à la rapporter de la même façon au Roman, alors que les références à la culture chinoise sont dûment invoquées. Il s’agit des préoccupations religieuses de Murasaki-shikibu, en particulier dans ce passage :
Quoi qu’il en soit, je ne me restreindrai pas dans mes paroles. Quoi que les gens puissent en dire, je pratiquerai sans relâche la récitation des Écritures au bouddha Amida. Par dégoût de ce monde, je n’y attacherai plus la moindre pensée, aussi ne flancherai-je point pour devenir ermite (hijiri). Quand bien même je rejetterai d’un seul tenant le monde, il se peut bien que je manque assez d’ardeur pour ne pouvoir monter sur la nuée (qui l’emportera à la Terre Pure d’Amida). C’est cela qui me fait hésiter. Je suis cependant à l’âge convenable pour partir. Alors que l’âge surviendra avec ses infirmités, que la vue défaillante empêchera en plus de réciter les Écritures, que l’esprit se fera de plus en plus fragile, au risque de passer pour imiter les gens de réflexion profonde, à présent il n’y a plus que cela qui me tienne à cœur. Le fait est qu’il n’est pas dit qu’une personne aussi pécheresse (que moi) puisse jamais parvenir à ses fins. Au nombre des choses que je peux savoir de mon existence antérieure, il y a lieu de m’attrister sur tout (ce qui m’arrivera par la suite).
Passons sur l’inquiétude dont fait montre Murasaki-shikibu à propos de son salut, comme une prémonition de ce qui deviendra plus tard la pièce L’Offrande au Genji, ce qui doit nous arrêter avant tout ici est l’expression de ce plan de carrière inattendu chez une dame de compagnie de l’impératrice. Il a fallu nous interroger sur l’acception du terme hijiri rendu par « ermite ». Le sinogramme utilisé pour écrire ce terme, shèng/shô, traduit le plus souvent par « saint », peut s’appliquer aussi bien, en lecture phonétique, à Confucius qu’au Bouddha, mais en lecture explicative hijiri, il évoque le plus souvent un religieux pratiquant à l’écart de sa communauté, un ermite donc, errant ou cloitré dans son ermitage. Nous l’avons vu apparaître à profusion dans les récits du Senjû-shô concernant Saigyô, mais Murasaki-shikibu elle-même l’utilise en ce sens dans le Genji. Le contexte dit bien que c’est cette acception que l’auteure a en tête : dégoût du monde, abandon du monde, entrée dans la vie érémitique. Elle n’est certes pas seule à son époque à penser ainsi. Sa consœur du Sarashina-nikki parlera aussi, dans les pages suivant celle que nous avons citée plus haut, d’entrer en religion, mais pas de devenir hijiri. Tout au long du Genji-monogatari, à la suite de chaque épisode tragique, l’une des premières réactions des personnages est de penser à se retirer du monde, une attitude de repli fort différente de ce qu’implique la conduite du hijiri, plus proche de l’ascèse individuelle que du cénobitisme. Si l’on prend Murasaki-shikibu au sérieux, dans un Journal qui par ailleurs rapporte de nombreux détails sur la pratique religieuse de la cour, détails dont nous avons relevé une partie dans le cours, et en l’absence de tout renseignement certain sur une entrée définitive dans les ordres, nous sommes fondé à nous interroger sur la façon dont la romancière a réalisé son vœu. Le mot « vœu » est à prendre ici au sens strict : la teneur de ce passage du Journal, aussi informel qu’il soit, l’apparente pourtant à un ganmon, à une « proclamation de vœu » par laquelle on explicitait l’intention et le but dans lequel on s’engageait dans un acte religieux, que ce soit un rituel ou une pratique à plus longue portée (on connaît la proclamation de vœu du moine Saichô avant de se rendre en Chine). Serait-il trop fantasque d’estimer que l’objet de son vœu pût être une œuvre littéraire, c’est-à-dire son roman ? Dès le début du xe siècle, le terme hijiri était employé dans la locution uta no hijiri, lecture explicative de kasei « saint de la poésie », expression chinoise dont la transposition en japonais donnait au second terme une dimension magico-religieuse nouvelle. Et le caractère essentiel des poèmes (uta) du Genji dans la construction de l’œuvre, caractère qui sera perçu et souligné par toute la tradition critique japonaise, peut donner à penser que Murasaki-shikibu elle-même employait ici le terme dans ce double sens, donnant à sa création littéraire une portée religieuse. Ce ne serait qu’une conjecture si l’on pouvait sérieusement mettre en doute le caractère profondément bouddhique du roman. Or, tout nous a amené à conclure qu’il est indéniable.
Extrait du site du Collège de France, https://www.college-de-france.fr/agenda/cours/le-roman-du-genji-poesie-langue-et-bouddhisme
- Détails
- Catégorie : Actualité en francophonie
Directeur d’études, EPHE (Ecole Pratique des Hautes Etudes)
Au tournant de notre ère et dans des circonstances qui demeurent obscures, des milieux brahmaniques orthodoxes mettent en place un dispositif cosmologique, celui des quatre « âges » (yuga), que rien ne remplacera plus dans l’imaginaire indien. Le système trouve des expressions abouties dès les fameuses Lois de Manu (Manusmṛti, iiie siècle), certaines sections récentes du Mahābhārata (iiie siècle?) et les couches les plus anciennes des Purāṇa (« récits d’antiquités », iiie-ive siècle). Selon cette conception, tout « microcycle » cosmique (une période d’environ douze mille ans) se compose de quatre âges successifs, de l’« âge d’or » (kṛtayuga) à l’« âge de la discorde » (kaliyuga; la nomenclature des quatre âges est empruntée à celle du jeu de dés, du coup gagnant au coup perdant), ponctué lui-même d’un yugānta ou fin du dernier âge. Dans sa valorisation purement cosmologique, ce modèle quaternaire se limite à une description de la dégradation religieuse (avant tout rituelle), morale, intellectuelle et physique de l’humanité. Le dispositif ne tarde toutefois pas à fournir un cadre à l’eschatologie brahmanique et à alimenter des prédictions apocalyptiques dont la plupart s’interprètent sans trop de mal comme autant de prophéties ex post facto décrivant un environnement socio-religieux, moral, politique et économique en crise. Y foisonnent fillettes enceintes, imposition excessive des brahmanes, rois impies, explosion des hérésies, joug étranger, inversion du cycle des saisons, mélange des castes, femmes infidèles et autres infamies.
- Détails
- Catégorie : Actualité en francophonie
« Le Collège de France est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche (établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel) dont l'ambition et les missions sont uniques au monde. Depuis 1530, le Collège de France répond à une double vocation : être à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. Voué à la recherche fondamentale, qu'il développe en partenariat étroit avec le CNRS, l’Inserm et de nombreuses institutions scientifiques et culturelles, le Collège de France possède cette caractéristique singulière : il enseigne « le savoir en train de se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ».
Les professeurs
Le Collège de France doit sa création à François Ier qui nomma en 1530 les premiers lecteurs royaux. Leur fonction était d’enseigner des disciplines qui n’étaient pas encore admises à l’Université. Aujourd’hui, les anciens « lecteurs royaux » sont devenus des professeurs travaillant avec plusieurs centaines de chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs.
- Détails
- Catégorie : Actualité sur Internet

William nous fait le plaisir de présenter sa démarche d’artiste photographe, “ancré dans l’instant présent, le coeur ouvert”. Un chemin inscrit également dans l’histoire tourmentée de notre époque.
« Photographier, c’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l’œil et le cœur » Henri Cartier Bresson
Cette citation de ce maître de la photographie qu’est Henri Cartier-Bresson représente bien mon expérience photographique… Une méditation dynamique où la vision se clarifie quand la tête et le cœur sont alignés.
C’est à l’adolescence que je découvre au même moment la photographie et le bouddhisme. Depuis, cet art visuel et cet art de vivre n’ont cessé de s'inspirer mutuellement.
En premier lieu, la pratique de la photographie m’a aidé à m’ancrer dans l’instant présent. Dans la méditation, j’ai dû développer une
- Détails
- Catégorie : Actualité de l'édition

Yongdzin Lopön Tenzin Namdak Rinpoché
Au Tibet avant l'exil
S.E. Yongdzin Lopön Tenzin Namdak Rinpoché est le détenteur actuel de la lignée de la tradition tibétaine Yungdrung Bön.
Il est né dans la province du Kham, en 1926. À l'âge de sept ans, il est entré au monastère de Tengchen pour commencer son éducation. De 1944 à 1948, Yongdzin Rinpoché vit et étudie avec son professeur et maître, Gangru Tsultrim Gyaltsan Rinpoché. Il passe une grande partie de cette période dans une grotte de méditation isolée au lac Juru Tso à Namtsokha, dans le nord du Tibet, où Gangru Ponlob Rinpoché lui enseigne la grammaire, la poétique, la discipline monastique, la cosmologie et les étapes du chemin vers l'illumination selon le soutrayana, le tantrayana et le dzogchen.
À la fin de l'année 1948, il rejoint le monastère de Menri, dans la province de Tsang, au Tibet central, pour y terminer ses études ; il obtient son diplôme de Geshe et est également élu pour succéder à son maître comme Lopön du monastère.
Il se rend au monastère de Sezhig sur le lac Dangra - un lac sacré pour les Bönpo - dans le nord du Tsang, où il reste en retraite personnelle jusqu'en 1960. Comme des dizaines de milliers d'autres Tibétains, Rinpoché a tenté de s'enfuir en Inde après le soulèvement de Lhassa contre les occupants communistes chinois, mais il a été blessé par balle et emprisonné par les communistes pendant dix mois avant de réussir à s'échapper par la frontière himalayenne vers le Népal. Au cours de son évasion, Yongdzin Rinpoché a pu dissimuler le célèbre stupa de Nyame Sherab Gyaltsen ainsi que des statues, des reliques précieuses et d'autres objets sacrés dans une grotte à Lug-do Drag dans la région de Tsochen, au Tibet. Pendant sa fuite, il emporta avec lui les précieux volumes de la transmission orale du Zhang Zhung Nyen Gyud et d'autres textes afin d'assurer leur préservation pour l'avenir.
- Détails
- Catégorie : Actualité de l'édition
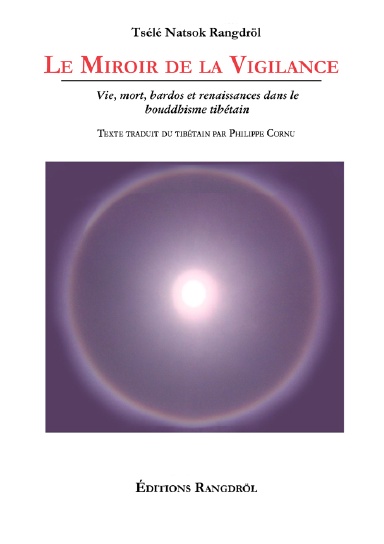
Philippe Cornu nous fait l’amitié de nous présenter son dernier ouvrage, Le Miroir de la Vigilance de Tsélé Natsok Rangdröl (XVIIe s.), dont il assure la traduction et un commentaire.
Le Miroir de la Vigilance de Tsélé Natsok Rangdröl (XVIIe s.) nous ouvre d’extraordinaires perspectives sur le sens de l’existence, hors des limites de nos cadres culturels habituels. Tout en constatant l’erratique voyage des êtres au sein du saṃsāra et son cortège de souffrances, ce texte montre qu’il est possible de s’affranchir des illusions de l’existence conditionnée et d’atteindre la liberté du plein Éveil à la fin de cette vie même ou après la mort. Traduit du tibétain, cet ouvrage embrasse tous les aspects de l’existence — de la naissance à la mort, le moment de la mort et la période entre la mort et la renaissance — tous désignés comme des bardo ou états intermédiaires de la conscience entre deux ruptures. Le Vajrayāna n’a qu’un seul but : révéler au yogi sa nature éveillée, ce prodigieux potentiel enfoui sous les souillures et les obscurcissements accumulés par le pouvoir d’une ignorance immémoriale, et chaque état intermédiaire représente
- Détails
- Catégorie : Actualité de l'édition

Khun Yay Maharatana Chandra Khonnokyoung upasika est la fondatrice du Wat Phra Dhammakāya, le plus grand temple bouddhiste de Thaïlande.
Didier Treutenaere nous présente dans ce texte la vie d'une femme exceptionnelle, dont chaque instant fut empli d'actes méritoires, dont chaque pensée fut tourné vers le nibbana et dont les vertus permanentes ont été la gratitude, le respect, la pureté de l'esprit, la discipline, la compassion, la persévérance et l'attention aux autres.
Chandra était une provinciale ; Bangkok était donc pour elle une terre inconnue. Et il n’était pas si facile d’être acceptée au Wat Paknam. En général, un étranger ne pouvait rejoindre la communauté des fidèles du temple, et encore moins intégrer sa congrégation, sans avoir été parrainé par une personne déjà connue du temple. Chandra n’avait aucun contact de ce genre. Au début, elle s’installa dans la maison de parents éloignés. Mais son but était de trouver à s’employer dans la demeure d’une famille pratiquant la méditation au Wat Paknam. Elle attendit donc que survienne une telle occasion. Cette opportunité se présenta enfin, en la personne de Khun Naï Liap Sikanchananand, une femme de l’aristocratie qui habitait à Saphan Han. Khun Naï Liap était connue du Vénérable du Wat Paknam. Elle était même considérée comme faisant partie des principaux donateurs du temple dans la mesure où elle offrait régulièrement, depuis plus de vingt ans, des repas pour les moines et les novices. Sa famille était à la fois fortunée et influente. Elle était propriétaire de plusieurs kilomètres de boutiques et possédait également sa propre société d’import-export. Chandra sut que tel serait le lien dont elle avait besoin pour être introduite au sein du Wat Paknam.
- Détails
- Catégorie : Actualités

Les Trésors du Nord sont une branche de l’école Ancienne (Nyingma) du bouddhisme tibétain. Cette école, tout en étant aussi l’héritière de traditions antérieures, a pour noyau principal les révélations (termas, « trésors cachés ») de Rigdzin Gödem ou Ngödrup Gyaltsen (1337-1409 selon la chronologie communément retenue). À l’époque récente, les Trésors du Nord ont surtout été connus par deux maîtres tibétains de l’exil : Taklung Tsetrul Rinpoché, représentant sa branche principale du Tibet Central, liée au monastère de Dorjédrak, et Chimed Rigdzin Rinpoché, maître de sa branche orientale, implantée au monastère de Khordong au pays Golok.
Les « trésors cachés » sont, selon la tradition Nyingma, des objets et des textes sacrés cachés en toutes sortes de points du territoire tibétain notamment par Padmasambhava, maître indien venu au Tibet à l’époque du roi Trisong Detsen (deuxième moitié du VIIIe siècle).
Rigdzin Gödem était considéré comme la réincarnation d’un des disciples de Padmasambhava, Zhang Nanam Dorjé Düdjom ; sa naissance était annoncée par de nombreuses prophéties. Il naquit dans une famille revendiquant une ascendance royale ; ses ancêtres étaient tous, dit-on, des praticiens de Vajrakīla et d'un système de Dzogchen appelé le Cycle du Brahmane. Son père, appelé Lopön Sidüdül, était un pratiquant de Vajrakīla ainsi que sa mère, Jocham Sonam Khyudren. On dit qu’il fut conçu alors que tous deux étaient absorbés par la pratique de cette divinité.
Les hagiographies insistent sur le caractère « courroucé » de Gödem en relation avec Vajrakīla, y compris quant à la description de ses marques corporelles, dont la plus remarquable était quelque chose qui (selon la tradition) ressemblait à des plumes de vautour poussant sur le sommet de sa tête – trois dans sa douzième année, cinq dans sa vingt-quatrième année – d’où le surnom sous lequel il est connu, Rigdzin Gödem, le « détenteur de connaissance au toupet de [plumes] de vautour ».
Il est dit qu'en sa treizième année, il obtint des réalisations grâce à la Roue des activités de la lèpre noire. C’est un tantra lié à Yamāntaka sous la forme Nāgarākṣa. Il reçut les enseignements de divers maîtres encore mal identifiés, outre ceux de son père : Draklungpa Khetsun Rinchenpal, Khepa Nangden Gyalpo, etc. Rigdzin Gödem est dépeint comme s’étant appliqué, depuis son plus jeune âge, à recevoir et pratiquer les traditions tantriques caractéristiques des Nyingmapas. Cela mérite d'être souligné, car d'autres « découvreurs de trésors » sont présentés comme des êtres spontanément éveillés, sans lien avec une lignée humaine ordinaire de transmission spirituelle. Dans le cas de Rigdzin Gödem, quelles qu’aient été ses qualités spontanées, il a reçu instructions et initiations de maîtres humains.
C'est à partir de sa vingt-cinquième année que commence sa vie de découvreur de trésors (tertön).
Il trouva d'abord des lieux insolites et des objets magiques, et non, à l'origine, des textes. Puis, dit-on, toutes sortes de présages se produisirent, correspondant à des prophéties, annonçant que les temps étaient mûrs pour qu’un terma soit découvert à Zangzang Lhadrak. Alors, diverses indications nécessaires à la découverte du trésor ayant été trouvées par un certain Zangpo Drakpa de Manglam, ce maître s’arrangea pour que ces cartes et clés du trésor sacré parviennent, au début de 1365, à Rigdzin Gödem, prédestiné à les découvrir.
Une caractéristique très particulière, mais pas absolument unique, des « Trésors du Nord » est leur lien constant avec les pouvoirs politiques.
Il avait été prophétisé qu'il serait de bon augure que Tashidé, le roi de Gungthang (règne : 1352-1365), fournisse les substituts aux trésors à extraire (en effet, selon les croyances tibétaines, il convient de remplacer les substances puissantes que l’on extrait du sol par des choses tout aussi précieuses). Malheureusement – en raison de la faiblesse des mérites, disent les textes – ce roi dont la prophétie voulait que la rencontre avec Rigdzin Gödem et ses révélations fût particulièrement propice mourut en 1365, avant que le trésor puisse être extrait du lieu où il était caché, et il est dit qu’il ne fut possible d’établir qu’un lien médiocre avec son fils Phüntsokdé (lequel, pour cette raison, allait mourir dans sa trente-troisième année, en 1370).
Alors que le moment précis de l'ouverture du lieu où reposait le terma était proche, Rigdzin Gödem dut se rendre à Sakya, où Phüntsokdé se trouvait alors, et le persuader d'accorder les substances précieuses – or, etc. – qui devaient être substituées aux « trésors cachés » au moment de leur extraction.
Stéphane Arguillère
Note : la 2ème partie sera publiée dans la newsletter de juin 2022.


