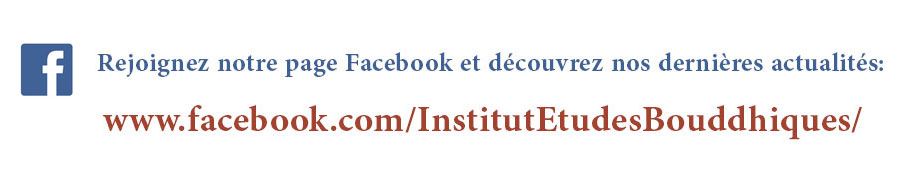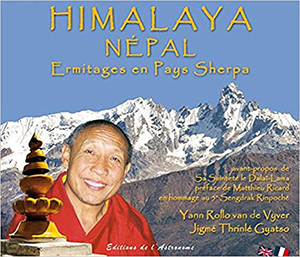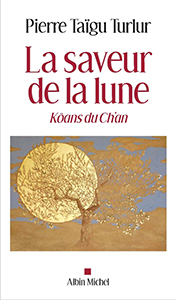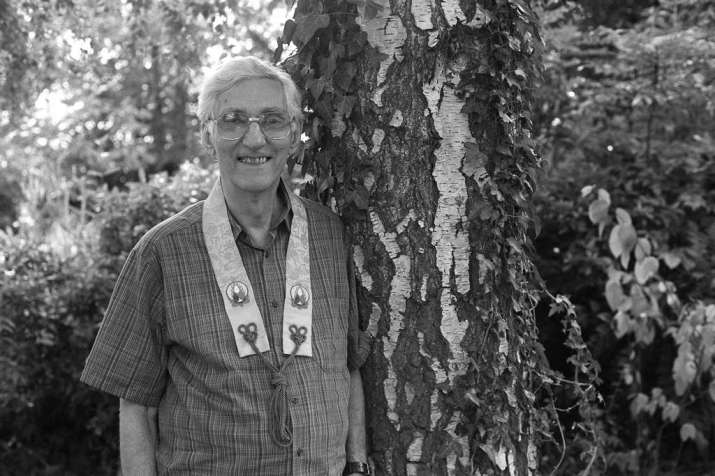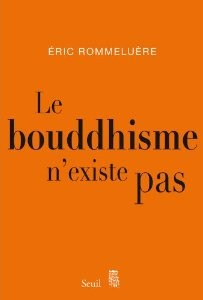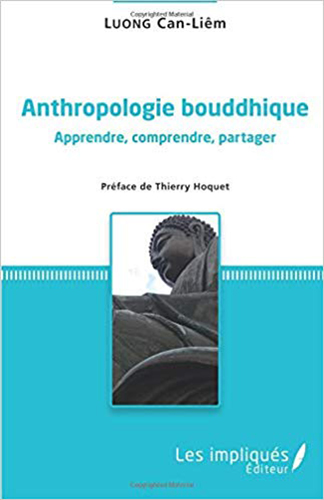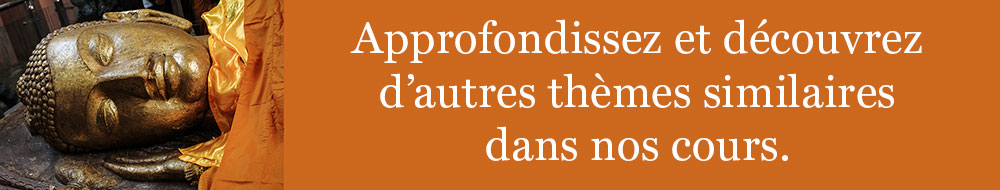Actualités
- Détails
- Catégorie : Actualité de l'édition
En Himalaya, dans la région du Langtang, les ermitages monastiques népalais de Liping et de Bakhang ont été fondés par le maître bouddhiste de la lignée Drukpa, Sengdrak Rinpoché, tout près de la frontière avec le Tibet d'où il était originaire. Moine bouddhiste et poète, Jigmé Thrinlé Gyatso s'est associé au photographe Yann Rollo van de Vyver pour réaliser cet ouvrage qui raconte simplement la vie monastique et érémitique en Himalaya.
- Détails
- Catégorie : Actualité de l'édition
« Quel est ton visage avant la naissance de tes parents ? » Les kôans du ch'an (zen, en japonais), invitent chacun à contempler et à vivre sa nature véritable. À travers des anecdotes truculentes, des aphorismes surprenants, des sentences paradoxales, souvent cocasses mais toujours inspirantes, le kôan nous permet de nous débarrasser du connu et de faire l'expérience directe de la réalité.
- Détails
- Catégorie : Actualité sur Internet
Dans un coin tranquille du bush australien, près de la ville de Bendigo, à environ 160 km au nord-ouest de Melbourne, se déroulent les travaux de construction de ce qui sera l'une des plus grandes structures bouddhistes du monde occidental : le « grand stūpa de la compassion universelle ». Réplique modernisée du stūpa de Gyantse, monument bâti au Tibet au XVe siècle, le « grand stūpa de la compassion universelle » s’élèvera à près de 50 mètres de hauteur sur une base carrée de 50 mètres de côté. À l'intérieur, la salle principale abrite déjà l'un de ses biens les plus précieux : le « Buddha de jade pour la paix universelle », une statue haute de 2,5 m, d’un poids de quatre tonnes, taillée dans un seul bloc de jade...
- Détails
- Catégorie : Actualité sur Internet
Le révérend Kenjitsu Nakagaki veut apprendre aux occidentaux l'histoire du manji, le nom que les Japonais donnent à la svastika. S'il s'agit d'un symbole tabou en Occident, du fait de son détournement par les nazis sous la forme de la "croix gammée", la svastika fait partie de la culture japonaise depuis l’introduction du bouddhisme et ce bonze souhaite que l'Occident comprenne que, pour de nombreuses religions, il s'agit avant tout d'un symbole de paix !.
- Détails
- Catégorie : Actualité en francophonie
Sa Sainteté Ogyen Trinley Dorje et Sa Sainteté Trinley Thaye Dorje, tous deux prétendants au titre de 17e Gyalwang Karmapa, se sont rencontrés secrètement en France et ont publié une déclaration commune, le 11 octobre 2018. Ils souhaiteraient apparemment résoudre le conflit qui dure depuis plusieurs décennies dans la lignée Karma Kagyü du bouddhisme tibétain concernant la question controversée de savoir qui devrait détenir le titre de 17e Gyalwang Karmapa, le chef spirituel de cette lignée de tülku la plus ancienne du Tibet.
- Détails
- Catégorie : Actualité sur Internet
Sangharakshita, né Dennis Lingwood à Londres en 1925, est décédé le 30 octobre 2018 à Hereford, en Angleterre. Enseignant bouddhiste parfois controversé, Sangharakshita a contribué, en Inde, dans les années 50, à l’instauration du bouddhisme ambedkarite, qui compte aujourd’hui des millions de fidèles et, en Angleterre, a fondé les Amis de l'Ordre Bouddhiste Occidental (AOBO) – devenue aujourd’hui la Communauté Triratna – l’un des courants bouddhistes occidentaux les plus populaires en Angleterre.
- Détails
- Catégorie : Actualité sur Internet
Soixante-dix membres de l'Association Bouddhiste Zen Sōtō (SZBA) – une association de prêtres (*) Zen Sōtō des États-Unis – se sont récemment réunis à New York, pour la huitième conférence bisanuelle de leur organisation. Durant quatre jours, plusieurs des intervenants se sont exprimés sur des sujets sensibles aux États-Unis comme la sur-représentation des blancs dans le bouddhisme nord-américain, le mouvement #MeToo et les questions de ségrégation, sexuelle ou de genre, comme aussi la non-reconnaisance des droits des Amérindiens. La cérémonie traditionnelle de confession – durant laquelle le pratiquant bouddhiste reconnaît les erreurs qu’il a pu commettre et s’engage à ne pas les renouveller – fut l’occasion de lire un « acte de repentance » concernant toutes les discriminations et violences faites aux êtres, surtout si elles sont perpétrées au nom de la religion et, notamment, du bouddhisme…
- Détails
- Catégorie : Actualité de l'édition
Avec « Le bouddhisme n'existe pas », récemment paru aux éditions du Seuil, Eric Rommeluère nous propose de partager une longue réflexion sur le processus d'interprétation de l'enseignement du Buddha.
Le titre a quelque chose de provoquant, c'est certain... et l’auteur s’en explique dans sa préface.
Comme il le précise aussi en titre de l'un de ses chapitres : « Le bouddhisme n'est pas le dharma ». Le premier est une invention de l'Occident, un -isme qui restreint l'enseignement du Buddha à n'être qu'un ensemble de doctrines, un savoir sujet de controverses, quelque chose qui dépend du langage et du raisonnement, quand le dharma, lui, peut se transmettre aussi par le silence et demande d'outre-passer le rationnel et le raisonnable... Le « bouddhisme » ramène l'inconnu au connu, alors que le « dharma » exige d'entrer dans l'inconnu, de lâcher-prise et de se laisser bouleverser...
Mais Eric Rommeluère ne fait pas qu’évoquer cette seule constatation, que d'autres ont déjà fait avant lui. Pour lui, l’enjeu est de taille : comment réellement transmettre l’enseignement du Buddha en Occident ? C’est-à-dire comment l’interpréter – comme l’ont toujours fait les disciples du Buddha, au fil des siècles, en fonction des lieux et des époques – sans pour autant l’adapter à notre convenance ?
Une critique de ce livre ne lui rendrait pas justice... Car Eric Rommeluère invite son lecteur à le suivre dans son approche du dharma, au fil de pensées, de critiques, de questionnements - et de quelques réponses, aussi ! Nous vous proposons donc, plutôt, de découvrir la préface de l’ouvrage et l’un de ses chapitres intitulé « Le discours et la méthode ».
- Détails
- Catégorie : Actualité sur Internet
Le gouvernement indien a indiqué récemment qu’il revisait sa position sur le XVIIe Karmapa, Ogyen Trinley Dorje, réfugié en Inde depuis le tout début de l’année 2000. Un haut fonctionnaire du ministère de l’Intérieur indien a notamment déclaré que les autorités étaient disposées à assouplir les restrictions qui lui avaient été imposées, quant à ses déplacements en Inde, et qu’il n’était définitivement plus soupçonné par les services de renseignement d’être un possible agent à la solde de la Chine. Un changement qui vise sans doute à bénéficier des faveurs de celui qui paraît pouvoir succéder au Dalaï-lama comme figure de référence de la communauté tibétaine et de tous les bouddhistes dits « tibétains »… un outil stratégique de poids face au puissant voisin chinois !
- Détails
- Catégorie : Actualité de l'édition
Siddharta Gautama, dit le Bouddha, a laissé un enseignement universel. Cet art d'exister se pare de "Trois Joyaux" dont la beauté est inépuisable. Bouddha, Dharma et Sangha peuvent s’interpréter comme "apprendre" de la vie, "comprendre" la vie, et "partager" cela avec sa communauté. Cet ouvrage tente de retracer ces enseignements et leurs subtilités ainsi que toutes les possibilités qui s'offrent à nous dans la pratique de l'enseignement de Buddha. Luong Can-Liêm est docteur en psychologie, psychiatre libéral, consultant à l'hôpital Sainte-Anne, à la Croix-Rouge et au Centre Minkowska pour la santé mentale des migrants (en 2006) et chargé de cours à l'Université Paris V. Il a déjà publié plusieurs ouvrages consacrés au bouddhisme comme Bouddhisme et psychiatrie (L'Harmattan, 1992) et Psychothérapie bouddhique (L'Harmattan, 2002).
- Détails
- Catégorie : Actualité sur Internet
Plus d'un an après la démission de Sogyal Rinpoché de son statut de chef spirituel de Rigpa – le réseau international de centres bouddhistes qu'il a fondé –, l’association a fait connaître les résultats d'une enquête indépendante, commandée à l'avocat britannique Lewis Silkin, suite à plusieurs accusations portées par des étudiants et des membres du personnel de multiples cas d'abus et de mauvais traitements qui auraient été perpétrés par le maître tibétain. Le rapport détaillé de 50 pages met en lumière de nombreux problèmes considérés comme « sérieux » et énumère une série de recommandations, notamment que Sogyal Rinpoché ne participe plus à aucun des futurs événements organisés par Rigpa, qu’il n’ait plus aucun contact avec ses disciples et que Rigpa prenne des mesures pour se dissocier de son fondateur « aussi pleinement que possible ».