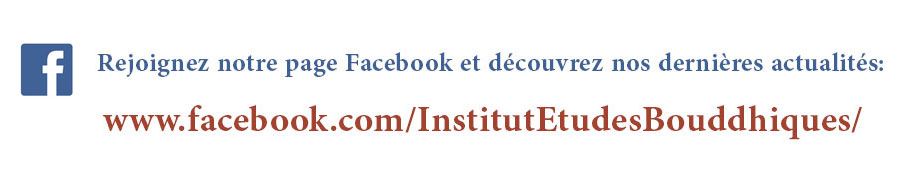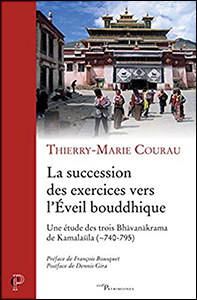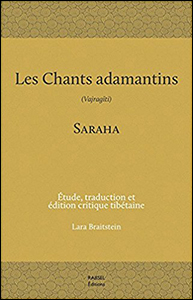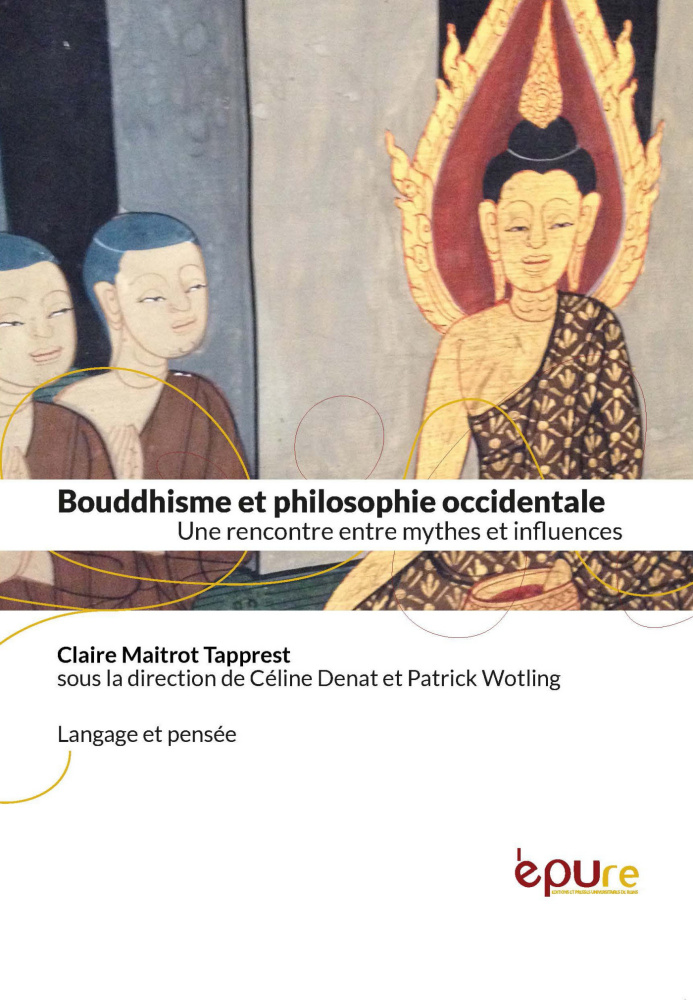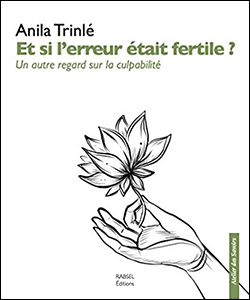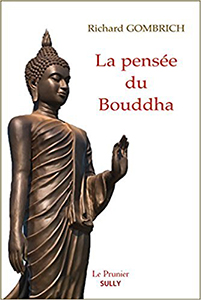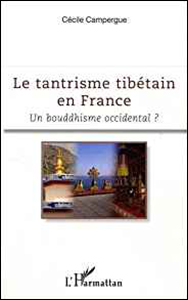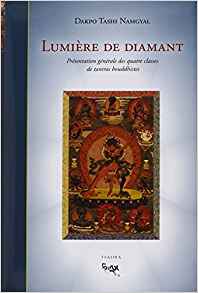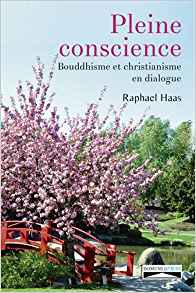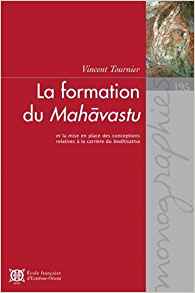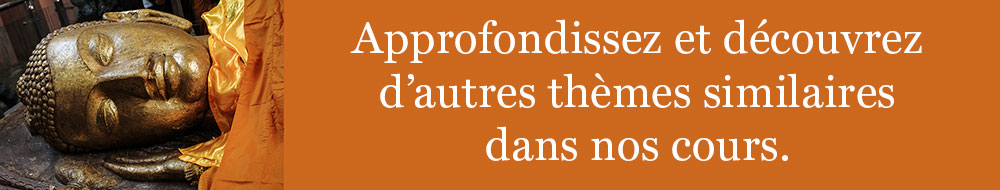Actualités
- Détails
- Catégorie : Actualité de l'édition
Entrer dans une intelligence fine des religions par des contenus déterminés est une urgence pour la réflexion théologique. Leur accès est souvent difficile car il s’agit d’entrer sans a priori, grâce à l’apprentissage de leurs langues, à l’écoute de textes et de pratiques qui font apparaître des visions du monde insoupçonnées, tout à fait singulières, voire étranges et dérangeantes. Le bouddhisme, bien qu’il semble familier aujourd’hui à beaucoup par une promotion et une instrumentalisation de sa « méditation », résiste à toute approche simpliste de ses doctrines. Le théologien Thierry-Marie Courau donne ici accès à la cohérence du chemin graduel vers l’Éveil parfait et complet d’un yogin bouddhiste du Grand Véhicule indien de la fin du VIIIe s., par une analyse des Bhāvanākrama de Kamalaśīla.
- Détails
- Catégorie : Actualité de l'édition
Le bouddhisme est-il une religion "verte" ou cette image est-elle un produit de l'imagination occidentale ? L'écobouddhisme, qui a fleuri depuis une trentaine d'années en Occident, laisse plus ou moins entendre que le bouddhisme - du fait notamment de sa vision de l'interdépendance de toutes choses - serait "écologique" par essence. Cependant, l'étude rigoureuse de la tradition originelle du Bouddha et de ses sources textuelles les plus anciennes ne permet pas d'accréditer une telle interprétation. En même temps, le bouddhisme dispose de ressources pour répondre au défi crucial de la crise écologique. Mais cela doit encore être pensé et articulé.
- Détails
- Catégorie : Actualité de l'édition
Traduits pour la première fois, "Les Chants adamantins" sont constitués d’un ensemble de trois poèmes de Saraha et jouent un rôle majeur dans la tradition tantrique du mahāmūdra (le grand sceau), en Inde et au Tibet. L’adepte tantrique Saraha faisait partie des figures les plus emblématiques de l’Inde de la fin du premier millénaire, une époque à l’activité religieuse et littéraire foisonnante. Son influence sur la pratique bouddhique ainsi que la poésie s’est étendue au-delà du sous-continent indien jusqu’au Tibet, où elle continue d’avoir un réel impact sur chaque tradition liée à la pratique et à la philosophie ésotérique du mahāmūdra. Dans ces chants, le point de vue de Saraha sur la nature de l’esprit est présenté autant sous la forme de poèmes évocateurs que d’exégèses théoriques.
- Détails
- Catégorie : Actualité de l'édition
Le XIXe siècle signe la découverte intellectuelle du bouddhisme par les Occidentaux, ouvrant alors de nouvelles perspectives. Cette nouvelle religion ne ressemble pas aux religions occidentales, elle désoriente et intrigue, mais remet aussi en question nos propres conceptions métaphysiques et religieuses. Ainsi, le bouddhisme est devenu un objet intellectuel dont les philosophes se sont emparés, et qui a tout à la fois influencé leur pensée, et atteint sous leur plume le statut de mythe. Ce ou ces mythes sont aussi des déformations du bouddhisme, et révèlent à quel point le christianisme a eu un impact sur la perception de celui-ci, qui restera pendant longtemps relié au néant, au pessimisme et au nihilisme, associations qui occultent sa véritable teneur.
- Détails
- Catégorie : Actualité de l'édition
Les souffrances de la culpabilité s'enracinent dans les jugements négatifs que nous portons sur nos erreurs. Or nos erreurs, tant cognitives qu'afflictives, sont inévitables ; elles naissent de nos représentations émotionnelles et imprécises qui nous emprisonnent dans notre version de la réalité. Ceci n'est pas un réel problème tant que nous en sommes conscients. Clarifier notre rapport à l'erreur nous amène à être moins piégés par nos jugements, ce qui nous permet de faire de nos erreurs un matériau de transformation. Par les méthodes issues de l'enseignement du Bouddha, et notamment l'entrainement à la méditation, notre rapport aux afflictions se clarifie.
- Détails
- Catégorie : Actualité de l'édition
Les Dialogues de Meou-tseu pour dissiper la confusion se présentent comme la première « défense et illustration » du bouddhisme en Chine. Ils auraient été composés par un lettré obscur, maître Meou, vivant dans les marches méridionales de l’empire des Han finissant. Versé à l’origine dans les Classiques confucéens et le Laozi, ce maître confronté à une situation politique dangereuse et chaotique, se tourne vers la « Voie du Bouddha ».
Un tel changement suscite des critiques telles qu’il doit descendre dans l’arène et tenter, à l’aide d’une rhétorique puisée dans la tradition classique chinoise, de préparer ses contemporains à l’enseignement, étrange et étranger, du Bouddha. Ses dialogues formeront plus tard un modèle pour les nombreuses controverses qui contribuèrent à définir les « trois enseignements », confucianisme, bouddhisme et taoïsme.
- Détails
- Catégorie : Actualité de l'édition
Dans « La pensée du Bouddha », le professeur Richard Gombrich, l'un des meilleurs spécialistes des études bouddhiques, soutient que le Bouddha est l'un des penseurs les plus brillants et les plus originaux de tous les temps, et que sa capacité d'abstraction a constitué une véritable percée intellectuelle. L'ouvrage se présente comme une introduction à cette pensée et, par là même, au bouddhisme. Il démontre que par l'étude des textes il est possible de retrouver la pensée originelle du Bouddha et d'en apprécier la cohérence et l'originalité en la mettant en relation avec le contexte historique des traditions brahmanique et Jaïn. L'ouvrage a reçu en 2010 le prix "Outstanding Academic Title" de l'association des bibliothèques américaines.
- Détails
- Catégorie : Actualité de l'édition
Pratiqué quasi-exclusivement par des Européens, le tantrisme tibétain en France est-il pour autant un bouddhisme occidental, un bouddhisme façonné et transformé par et pour les Occidentaux ? Il s'agit ici de cartographier ses tendances actuelles, de rendre compte de sa diversité et enfin de questionner le choix des "maîtres" concernant les seuils d'acculturation acceptables ou non afin de répandre l'enseignement du Bouddha.
Cécile Campergue est ethnologue, chargée de cours à l'Ucly (Lyon) et à l'IFER (Dijon) et postdoctorante au GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcités, CNRS-EPHE, Paris). Elle a déjà publié chez L'Harmattan sa thèse de doctorat remaniée: "Le rôle du maître dans la diffusion et la transmission du bouddhisme tibétain en France" (2012).
- Détails
- Catégorie : Actualité de l'édition
L'œuvre de Dakpo Tashi Namgyal (1513- 1587), maître renommé pour ses qualités d'érudit et d'accompli dans les tantra et le mahāmudrā, occupe une grande place dans l'école Dakpo Kagyü. Son œuvre Lumière de diamant est considérée comme un ouvrage de référence par tous les pratiquants et enseignants des tantra bouddhiques. Cette présentation de la pratique selon différents types de tantra prend appui sur un vaste corpus de textes racines et de traités indiens, incompréhensibles sans l'éclairage d'un guide qui en a une expérience authentique. La carte fiable et détaillée qui s'en dégage permettra au pratiquant avancé de franchir les étapes de la voie rapide du Vajrayāna - qui conduit le bodhisattva à l'état de buddha.
- Détails
- Catégorie : Actualité de l'édition
Parmi les maîtres bouddhistes les plus influents en Europe, le moine Thich Nhat Hanh apparaît comme incontournable. Ses très nombreux ouvrages traduits dans plusieurs langues attestent de son influence. L’originalité de la démarche s’affiche par la volonté de créer des liens avec des croyants de tous les horizons. Cet ouvrage montre tout le potentiel de sa vie et de ses enseignements, pour un dialogue avec le christianisme.
Raphael Haas est théologien, spécialiste du dialogue entre chrétiens et bouddhistes. Il enseigne la religion catholique à Bruxelles, tout en poursuivant sa recherche, après avoir étudié et vécu en Asie.
- Détails
- Catégorie : Actualité de l'édition
Les spéculations relatives aux buddha et aux bodhisattva s'épanouissent avec un remarquable dynamisme entre le Ier s. et le VIe s. de notre ère. Cette période dite « moyenne » ou intermédiaire du bouddhisme indien voit notamment l'affirmation progressive d'un nouveau courant, le Bodhisattvayāna, promouvant la voie du parfait Éveil. Le présent ouvrage retrace ces développements d'ordre « bouddhologique » au sein des milieux Mahāsānghika-Lokottaravādin, solidement implantés au Magadha et dans le nord-ouest de l'Inde. L'analyse historique se fonde sur une pratique philologique et consiste en l'étude de la formation et des vicissitudes du Mahāvastu, chapitre important de la « Corbeille de la Règle monastique » (Vinayapiṭāka) de cette école.