La question du végétarisme en bouddhisme a toujours fait débat, y compris au sein de la Communauté bouddhique elle-même... Depuis que l’Occident a découvert à son tour l’enseignement du Buddha, chercheurs et, désormais, adeptes de cette Voie ont tenté, à leur tour, de comprendre pourquoi cette pratique fort souvent préconisée – sinon même, parfois, exigée – est, dans les faits, aussi peu pratiquée !
Dans le numéro n° 7 de notre publication "Les cahiers bouddhiques" (mars 2012), Dominique Trotignon consacre un long article à ce sujet.
Les arguments des bouddhistes asiatiques sur cette question ont souvent semblé sybillins, voire hypocrites, à des observateurs venus d’un autre "monde". En reprenant cette controverse, tout au long de sa longue histoire, on peut néanmoins mettre en lumière les conditions, internes et externes à la Communauté bouddhique, qui ont justifié les préconisations comme les débats, parfois violents, qui ont opposé promoteurs et détracteurs d’un végétarisme absolu. Cette question ne saurait être réellement comprise sans la replacer dans le contexte doctrinal du bouddhisme et de ses notions essentielles : le conditionnement - y compris culturel et sociétal - de tous les phénomènes, la primauté de l’intention et de la motivation sur l’acte lui-même et, aussi, la prise en compte de chaque acte intentionnel au sein d’une même "ligne d’action". Au final, on se rendra compte qu’il faut distinguer, absolument, le fait de "se nourrir" de celui qui consiste à "se procurer de la nourriture".
Nous vous proposons, ci-dessous, deux extraits de cet article...
Bouddhisme et végétarisme : du temps des ascètes à l'époque contemporaine
Dominique Trotignon
deux extraits de l'article publié dans "Les cahiers bouddhiques" n° 7 (mars 2012)
[...]
2e partie : La nourriture des "moines" (bhikkhu)
[...]
Entre idéal ascétique et conventions "mondaines"
Contrairement aux ascètes solitaires, peu visibles, les "moines" bouddhistes (bhikkhu) doivent être vus et se rendre visibles : non seulement parce que, le bouddhisme reposant entièrement sur la motivation personnelle, on ne peut convertir par la force mais bien seulement par, mais aussi parce que d’autres communautés religieuses sont présentes dans les mêmes lieux et qu’il existe une très réelle concurrence entre elles. L’exemplarité devient ainsi la clé de voûte de la pratique monastique et vise à l’équilibre entre les conventions du "monde" et les exigences propres à la sainteté bouddhique "supra-mondaine". Le bhikkhu se doit, à la fois, d’être content de tout - puisqu’il pratique la vertu du contentement (et c’est d’ailleurs une interprétation étymologique possible du terme bhikkhu) - mais aussi de contenter les donateurs auxquels il enseigne et dont il dépend. Les vinaya [les recueils de "règles monastiques"] fixeront donc les usages à respecter pour satisfaire, à la fois, les exigences du milieu environnant et les exigences propres à l’enseignement bouddhique. Il conviendra de distinguer précisément ce qui relève des unes ou des autres.
Ainsi, par exemple, le vinaya précise-t-il qu’il existe dix chairs absolument "interdites". Sont ainsi exclues du régime carné : la chair humaine et celle d’animaux nobles ou royaux - éléphant, cheval, lion, tigre et panthère -, celle d’animaux impurs et répugnants comme le chien et la hyène, ainsi que l’ours et le serpent. Mais de telles restrictions n’ont rien à voir avec le bouddhisme lui-même, il s’agit là de prescriptions typiquement brahmaniques ; car le "monde" de l’Inde gangétique d’alors est devenu majoritairement brahmanique - ou, tout au moins, les brahmanes y sont-ils devenus de plus en plus influents. La prescription, ici, est purement conventionnelle.
Plus caractéristique du bouddhisme - bien qu’il s’agisse d’un trait commun à tous les mouvements ascétiques - est l’obligation de respecter le précepte de non-violence (ahimsa). Il s’exprimera aux travers de règles extrêmement contraignantes. Le vinaya interdit en effet aux bhikkhu de produire eux-mêmes leur nourriture : ils ne peuvent ni cuisiner ni jardiner, car de telles activités risqueraient de les exposer à détruire des êtres sensibles. Il leur est même interdit de procéder à la cueillette, ce qui les prive ainsi de l’auto-suffisance alimentaire dont bénéficiaient les ascètes forestiers. Les bhikkhu, poussant la vertu de contentement jusqu’à n’exprimer plus aucun "désir personnel", se placent ainsi en dépendance totale des maîtres de maison et doivent se contenter, strictement, de ce qui "tombe" dans leur bol à offrandes. Ils ne sont pas des mendiants pour autant…. Car le vinaya leur interdit aussi expressément de rien demander à qui que ce soit (hormis à des parents directs) de ce qui constitue les quatre "nécessités" (nourriture, habillement, logement et médicaments) dont ils doivent se contenter. Les textes, fortement marqués de l’ascétisme toujours préconisé, précisent : pour toute nourriture, celle reçue en offrande ; pour tout vêtement, quelques haillons abandonnés ; pour tout logement, l’abri des branches d’un arbre ; pour tout médicament, de l’urine de vache fermentée… C’est l’idéal.
Dans ce cadre, qui se révèle finalement beaucoup plus contraignant que celui des ascètes forestiers, les bhikkhu peuvent obtenir des offrandes de nourriture de deux manières. Dans le premier cas, ils cheminent dans les villes et les villages, à pas lent, en s’arrêtant devant chaque maison ; il leur est cependant interdit de rester stationnés plus que quelques instants, au risque de faire croire qu’ils mendient… Le chemin qu’ils empruntent changeant tous les jours, nul ne peut savoir à l’avance où ils passeront et la nourriture reçue, normalement, n’a donc pas été cuisinée à leur intention : il s’agit de la pitance préparée par et pour les maîtres de maison, qu’on ampute incontinent d’une portion quand l’occasion d’effectuer un don "bienfaisant" se produit. Dans le deuxième cas, un maître de maison prépare intentionnellement de la nourriture en vue de l’offrir, soit qu’il l’apporte lui-même au monastère, soit qu’il invite des bhikkhu à venir s’en restaurer chez lui.
Dans ce cas, tout particulièrement, une nouvelle injonction s’applique qui manifeste une caractéristique cette fois spécifique du seul bouddhisme : l’attention portée à l’intention (cetanâ) à l’origine de l’acte est l’un des fondements essentiels de la doctrine bouddhique. S’il est dix viandes strictement interdites, c’est donc que toutes les autres sont a priori autorisées, mais le bhikkhu qui en recevrait doit néanmoins "éviter" de manger de la viande dont il a vu, dont il sait ou dont il peut soupçonner qu’elle provient d’un animal intentionnellement abattu pour son repas. Car il est impensable qu’un bhikkhu produise une occasion qui mettrait en péril d’autres êtres vivants, l’acte violent fût-il exécuté par quelqu’un d’autre que lui - surtout s’il s’agit d’un dévot bouddhiste qui est sensé, lui aussi, pratiquer la non-violence. Si cela se produit malgré tout, il conviendra alors d’éviter d’en manger - le mal étant déjà fait, les reproches seraient tout à fait inutiles, mais l’évitement du produit alors considéré comme "immangeable" doit suffire de leçon au donateur impénitent. Dans la pratique, cet évitement constitue néanmoins un refus.
Cette injonction ne concerne pourtant pas un bhikkhu qui, malade physiquement, aurait besoin de viande pour rétablir sa santé, de même que pour un bhikkhu qui, atteint de maladie mentale, ne serait pas en mesure d’apprécier correctement les circonstances. Enfin, si un bhikkhu en bonne santé s’alimentait malgré tout d’une viande ne répondant pas à cette condition trine, il n’y aurait pas "faute" pour autant et la règle ne prévoit, en ce cas, aucune "sanction" autre qu’une simple "confession" publique assortie de la promesse d’être plus vigilant à l’avenir... Ces "exceptions" semblent ouvrir tout grand la porte aux pires abus imaginables : on peut aisément feindre la maladie - physique ou mentale - ou bien prétendre faussement n’avoir éprouvé aucun doute… Qui prouvera le contraire ? Elles sont pourtant caractéristiques du fondement proprement spirituel du vinaya, qu’il convient d’expliquer.
[…]
La nourriture comme médicament
Il est aussi particulièrement important, ici, de distinguer entre le fait de se procurer de la nourriture et celui de se nourrir.
Pour le bouddhisme, les deux actes ne peuvent relever d’une seule et même intention et c’est là ce qui va les différencier. L’ingestion de nourriture relève du désir d’apaiser la faim ; ce désir "naturel et nécessaire" (pour reprendre les catégories d’Epicure…) peut néanmoins s’accompagner, parfois, d’un autre désir, celui du plaisir sensuel qu’apportent certaines nourritures – gourmandise, désir "naturel mais non nécessaire", qui fait préférer la viande goûteuse au déjeuner de feuilles insipides…! - plaisir sensuel que le bhikkhu doit apprendre à maîtriser, puis abandonner totalement. Mais le désir de s’approprier de la nourriture, la manière de s’en procurer, relèvent d’une tout autre catégorie.
Là où, très généralement, l’Occident envisage une série d’actes successifs en fonction de leur conséquence finale commune, le bouddhisme, lui, va très précisément distinguer autant d’intentions qu’il y a d’actes particuliers… Pour lui, chaque acte a sa motivation propre et, selon la formule consacrée, le Buddha est "celui qui établit des distinctions". Un commentateur bouddhiste contemporain, pour illustrer la chose, évoque le cas de Robin des Bois : l’Occident l’applaudit généralement de voler les riches pour donner aux pauvres ; le bouddhiste, lui, distinguera le fait de donner - acte "bien-faisant" par excellence - et le fait de voler, acte toujours malfaisant : "bien mal acquis ne profite jamais", quelle que soit la manière dont on en disposera ultérieurement, fût-ce pour faire le bien !
C’est pourquoi le Vinaya distingue si précisément les manières adéquates de "recevoir la nourriture", quand d’autres textes préciseront, de leur côté, les manières adéquates de "se nourrir". Car le désir d’apaiser la faim est un désir "sain", en ce sens qu’il vise à maintenir le corps en bonne santé, et cette caractéristique est tout à fait fondamentale pour les bouddhistes. Dans sa définition de la "juste Voie du Milieu", le Buddha avait bien précisé qu’il fallait se tenir à égale distance de deux extrêmes : la recherche des plaisirs sensuels, à la manière des maîtres de maison ordinaires, tout comme la mortification excessive pratiquée par les ascètes des autres courants spirituels. Le disciple du Buddha ne doit ainsi privilégier ni le corps au détriment de l’esprit - comme le ferait un gourmand glouton - ni l’esprit au détriment du corps - comme un ascète extrémiste. Corps et esprit sont dits indissociablement liés, "ainsi que deux bottes de roseau qui s’appuient l’une sur l’autre" ; si l’une tombe, l’autre la suit inéluctablement. Aussi convient-il de considérer le corps comme un "outil de pratique" indispensable dont la bonne santé doit être préservée.
A chaque repas, les bhikkhu sont d’ailleurs invités à réciter une stance introductive - véritable exercice spirituel préparatoire - qui déclare : "Ces offrandes de nourriture que nous allons consommer maintenant, avec attention, ne le seront pas par jeu, ni pour leur goût, ni pour prendre du poids, ni pour la beauté du corps, mais simplement pour l’entretien de ce corps par ingestion d’un aliment, pour le maintenir en bonne santé, afin de pouvoir suivre la vie sainte, et en réfléchissant ainsi : ‘Je vais détruire les anciennes sensations de faim et n’en produirai pas de nouvelles [du fait d’avoir trop mangé]. Ainsi s’effectuera la libération de l’inconfort physique et il sera possible de vivre à l’aise’…". Se nourrir correctement – et de viande si nécessaire – participe donc d’une juste motivation, celle de pratiquer l’enseignement du Buddha dans les meilleures conditions possibles.
Ce refus, clairement exprimé et répété, de toute ascèse inutile - voire effectivement dommageable à la pratique spirituelle - sera l’objet central d’un épisode très célèbre et constamment cité par ceux qui s’opposent à un végétarisme absolu. Selon la tradition, alors qu’il était déjà vieux et fatigué, le Buddha se trouva régulièrement en butte à l’un de ses disciples nommé Devadatta, qu’on dit être l’un de ses cousins issu de la famille royale des Sâkya. Ce "méchant cousin" sera accusé de multiples forfaits, tous plus abominables les uns que les autres, en véritable "bouc émissaire". Parmi ceux-là, celui d’avoir exigé du Buddha qu’il impose à tous les bhikkhu cinq règles ascétiques, dont une concernait le fait de s’abstenir de toute nourriture carnée, viande ou poisson. Le Buddha refusera d’imposer ces règles à tous mais en autorisera néanmoins la pratique, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, à ceux qui le voudraient ; ces règles, aujourd’hui au nombre de treize, sont connues sous le nom de "pratiques austères" (dhutanga).
Historiquement, on a désormais clairement établi que l’épisode est anachronique, que Devadatta, loin d’être un "méchant cousin" du Buddha devait être un ascète forestier vivant plusieurs générations après lui, que l’anecdote anachronique reflète le débat, vif à l’époque de sa mise en forme, qui opposa les bhikkhu, résidents citadins, aux ascètes, forestiers et itinérants. Plus d’un millénaire après la date supposée de l’événement, des pèlerins bouddhistes venus de Chine déclarent avoir rencontrés en Inde du nord des disciples de Devadatta, refusant d’honorer le Buddha, et effectivement plus stricts sur la manière de se nourrir que la plupart des autres bouddhistes… en l’occurrence, le temps passant, ils ne refusaient plus que les seuls produits laitiers et consommaient eux aussi de la viande et du poisson !
Du point de vue des bhikkhu stricts "traditionnalistes", l’affaire est donc entendue : l’abstinence de viande et de poisson n’est pas la pratique "ordinaire" de ceux qui suivent la Voie du Milieu, mais un extrême seulement "autorisé" de manière tout à fait exceptionnelle. Le critère le plus important demeure l’exigence d’une bonne santé physique, ce qui explique qu’un bhikkhu malade n’est pas même tenu de respecter la règle trine sur l’origine des "viandes autorisées". Si son état de santé l’exige, il peut, voire il doit consommer de la viande, quelle que soit son origine, même après midi, puisqu’il s’agira alors d’un aliment considéré comme un médicament.
Les traditionalistes peuvent se réclamer de l’exemple du Buddha lui-même car plusieurs textes évoquent le fait qu’il s’est lui-même nourri de viande, à l’occasion. C’est d’ailleurs lors d’un repas carné, offert par un riche donateur, qu’il édictera la règle trine sur l’origine des viandes autorisées. Mais l’exemple le plus célèbre, qui alimentera durant des siècles les débats entre végétariens et anti végétariens, est celui de son dernier repas. Quelques jours avant sa "disparition définitive" (pari-nirvâna), le Buddha accepte l’invitation à déjeuner d’un charron, qui lui offre un plat nommé "délice de cochon". Les exégètes - bouddhistes ou non - n’ont jamais pu déterminer si cette appellation désignait un plat de chair de cochon ou un plat de champignons dont le cochon fait ses délices… Toujours est-il que le texte précise que le Buddha s’en nourrira, tout en interdisant aux autres convives d’en manger : il aurait été "indigeste" pour tout autre qu’un Buddha. Cela dit, sa dangerosité concernera le Buddha lui aussi puisqu’on déclare que c’est ce "délice de cochon" qui provoquera la dysenterie qui finira par l’emporter… En tout état de cause, il s’agissait d’une nourriture jugée "malsaine" et si le Buddha s’autorise seul à en consommer, c’est peut-être parce que, quelques jours auparavant, il avait décidé "d’abandonner son principe vital" - c’est-à-dire de ne plus se maintenir volontairement en vie. Lui, et lui seul, pouvait s’exposer alors à une maladie mortelle, puisqu’il avait accompli son œuvre et n’avait plus besoin d’entretenir son corps en bonne santé : "Ce qu’il y avait à faire a été fait, il n’y a plus rien à faire", comme le dit la formule consacrée. Les autres convives, eux, encore "en chemin", se devaient de ne pas mettre en péril le corps "support de pratique" dont ils avaient encore besoin…
Ce que les bouddhistes traditionnalistes exposent ainsi à travers leur vinaya, au regard de la nourriture, c’est donc très précisément un "régime" alimentaire, au sens médical du terme ! Et, pour reprendre les habitudes des zélateurs modernes occidentaux du bouddhisme - qui voient en lui l’inventeur anachronique de nos idéaux contemporains - on pourrait dire que la viande, pour eux, constituait un "alicament" avant la lettre… Au nom d’un pragmatisme réaliste, qui ne sera néanmoins pas toujours exempt d’une certaine hypocrisie, on ne reniera donc pas le caractère omnivore de la nature humaine. Et il ne sera donc jamais question d’abandonner la consommation de viande suivant le principe qu’elle peut être utile à celui qui s’en nourrit pour la préservation de sa santé physique, elle-même indispensable à sa pratique spirituelle. Seuls ceux qui peuvent s’en passer - car omnivore veut aussi dire que la viande n’est pas pour autant indispensable à tous et à tout moment… - pourront, à l’occasion, et dans le cadre strict et temporaire d’un entraînement plus intensif, se dispenser d’un aliment jugé trop goûteux, qui risquerait alors de les empêcher de parvenir à leur but : la maîtrise totale des désirs visant la satisfaction des plaisirs sensuels.
Pour en savoir plus
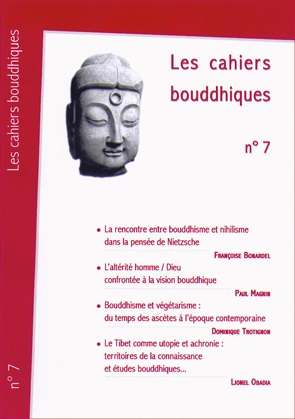 Les cahiers bouddhiques n° 7
Les cahiers bouddhiques n° 7
Consulter la page de présentation sur notre site.
